A force de sauter sans jamais trébucher, de contourner des citadelles hérissées de créneaux en armes, de dérouter la poursuite des loups au point que, en meute ou solitaires, il semble les apprivoiser dans l’instant d’un regard, d’une volte, d’une contre-volte; à force de le voir prendre le pli de tous les tumultes dont les champs
A force de sauter sans jamais trébucher, de contourner des citadelles hérissées de créneaux en armes, de dérouter la poursuite des loups au point que, en meute ou solitaires, il semble les apprivoiser dans l’instant d’un regard, d’une volte, d’une contre-volte; à force de le voir prendre le pli de tous les tumultes dont les champs de bataille sont le drame obligé, avec l’insolente facilité que lui permettent ses foulées en turbine; à force de le voir, semaine après semaine, reproduire ses hauts faits d’armes dans tous les tournois où les meilleurs se donnent rendez-vous devant toutes sortes de témoins, hostiles ou acquis à sa cause; à force d’être Lionel Messi, on l’a canonisé de son vivant.
On en est même venu à penser qu’il était irremplaçable, dans l’une de ces ambiances très «après lui le déluge» faites pour censurer toute interrogation, forcément sacrilège, sur ses conditions de possibilité. Comment, Dieu, un tel phénomène est-il possible? De sorte que, lorsque la nouvelle tomba sur la Ciutat Comtal, ce fut sèchement. Comme une guillotine.
Une autre version que l’Immaculée Conception
Quand, l’été passé, Messi manifesta un peu plus fermement que d’ordinaire sa volonté de faire le mur de la Cité qui l’a consacré roi, les spéculations des prophètes de malheur se donnèrent libre cours: «Retenez-le, malheureux! Son départ sonnerait le glas de nos victoires en cascades.» Derrière cette crainte panique ne cesse de courir, dans toute la gamme de ses modulations, l’idéologie du don et des essences éternelles. Tout se passerait comme si, pour tous ceux qui brillent au firmament de leur discipline, il n’était pas question d’acquisition de dispositions de mieux en mieux adaptées aux réquisits de leur sport, mais de don.
Nous sommes en mesure de proposer une autre version de l’histoire que celle de l’Immaculée Conception: un individu, en l’occurrence un footballeur professionnel, a été si bien modifié qu’il semble aujourd’hui se jouer des lois gravitaires qui déterminent le commun. Lionel Messi est un homme. Comme nous tous, il a été formé, puis modifié, par ses apprentissages. Cette modification, dans son cadre strictement sportif à tout le moins, est un empuissancement. Une augmentation de l’être. Stupéfiante. Voyons à partir de quelle théorie il nous est donné de le comprendre.
«Tumulte», disions-nous. «Chaos», affinerait Henri Poincaré (1854-1912), car mieux en accord avec l’origine mathématique de la théorie des systèmes dynamiques. Pour autant que l’on parvienne à en maîtriser le langage, finement articulé de concepts nombreux et référant à la réalité de manière souvent métaphorique, la théorie des systèmes dynamiques (désormais TSD) nous donne une vue causale imprenable sur ce halo de mystère entourant l’adaptation miraculeuse de certaines entités (individuelles ou collectives) à des situations sans ordre apparent, «chaotiques» donc.
Une capacité d’ouverture aux complexités
Appliquée au Camp Nou et à son centre de gravité argentin, la TSD jette une lumière particulièrement éclairante sur la complexion de ces «corps-esprits», à l’exemple de Messi et de ses satellites qui, dans des situations confuses au commun (le «chaos»), savent y voir les possibilités pratiques («affordances») d’un ordre fugitif («métastable»): où abriter le ballon, le conduire; où contourner le rideau adverse en produisant des résonances empathiques avec les cycles «perception/action» constamment renouvelés des coéquipiers alentour.
La TSD est une langue merveilleuse, flûtée et aride à la fois, pleine «d’attracteurs» perfides, de «bifurcations» anxiogènes, de «bruits» sourds aux résonances colorées de «blanc» et de «rose». C’est une langue ensorcelante, mais non dénuée d’ambiguïtés. Car de quoi parlons-nous, au juste? De Messi? De ses interactions avec ses coéquipiers? De la réalité qui, face à l’adversité sportive, en émerge et que l’on pourrait appeler le FC Barcelone? Ou de cette entité «macro» que forment deux équipes qui s’affrontent? Des quatre. Dans leurs intrications.
Le Barça n’est pas solide, il est liquide
En langage TSD, cette faculté «d’ouverture» aux complexités du «système jeu» (le mot est lâché), lorsqu’elle est régulée comme nous le verrons par les lois inhérentes au «système joueur» et au «système équipe», constitue l’indicateur le plus sûr de leur puissance. Ces systèmes sont ouverts les uns sur les autres au point que, en certaines «phases» de leur «accouplement structural», ils opèrent des «transitions» qui rendent vain le projet de vouloir les dissocier.
L’insaisissable Francisco «Paco» Seirul-Lo, professeur des sciences du sport à l’Université de Barcelone et responsable de la méthodologie du Barça durant les années 1994-2014, ne disait pas autre chose lorsqu’il affirmait à Marti Perarnau, non sans raison: «Le Barça n’est pas solide, il est liquide […]. C’est une définition que je crois très appropriée.» En effet. Métaphore de ce corps sans tête apparente, flexible, insaisissable et s’insinuant partout à la fois.
Le tout est plus que la somme des parties
Reste que, si la TSD est un anti-subjectivisme, elle ne noie pas pour autant les sujets d’exception dans le grand bain du collectif. Simplement, elle les relativise d’une manière très spéciale. Commençons par le commencement. Ainsi, la possibilité de participer à la complexité du jeu est le produit d’une propriété du «système/joueur» qualifiée d’ouverture à des situations de jeu («espaces de phases») où coexistent fugacement (un ou deux dixième de seconde) des composantes mutuellement exclusives qui s’attirent et se repoussent en fonction de certains paramètres comme l’emplacement du ballon, la dynamique des corps en mouvement, les affinités des joueurs impliqués, etc. Inutile de préciser la complexité de ces situations.
Or la relation d’ouverture du «système/joueur» à cet «environnement» «chaotique» est sous la dépendance de ses éléments internes et des «synergies» dont ils sont susceptibles. Par exemple, dans le cycle «perception/action» du système Messi, l’élément cognitif «lorsque mon vis-à-vis direct prend un appui avec le pied droit, je vais mon chemin par la gauche» est d’abord, soulignons-le, une véritable «ouverture» à la logique du jeu. Et elle a été automatisée. Elle entretient une synergie particulière avec l’élément moteur «vitesse». Dans l’esprit TSD, parler de «synergie» revient à dire que «l’élément moteur» en tant qu’il est capturé par l’élément «cognitif», ne se ressemble plus. Au fronton des principes de la TSD, le «tout» est toujours autre chose que la somme de ses parties.
Voyons maintenant à l’œuvre ces mêmes logiques de relativisation, mais au niveau collectif. Alors que sous le rapport du premier élément rien ne distingue le «système Xavi» du «système Messi» – ils ont reçu la même formation à cet égard – leur comportement général sur le terrain diffère considérablement en raison d’une différence notable sous le rapport du second. Xavi étant plus lent, il voit d’autres aspects du jeu qui n’en sont pas moins décisifs pour le «système équipe». Messi est relatif à Xavi et réciproquement. Leurs «attracteurs», c’est-à-dire le spectre de leurs comportements préférentiels, diffèrent, mais, au sens le plus littéral, s’entretiennent.
Xavi, c’est le football; Iniesta, c’est la magie; Messi, c’est le meilleur
A sa manière, Laureano Ruiz, inventeur autoproclamé des rondos, lorsqu’on l’interrogea sur les trois astres qui enluminèrent l’ère Guardiola, eut un trait qui nous le fit bien comprendre: «Xavi, c’est le football; Iniesta, c’est la magie; Messi, c’est le meilleur.» Alors que Messi incarne aussi bien le football que la magie, dès lors qu’on l’aligne comparativement à ses deux compères, la relativisation opère et nous n’éprouvons à aucun moment l’envie de le qualifier autrement. En définitive, la TSD est un perspectivisme: les «systèmes», joueurs ou équipes, se donnent «l’environnement» que leur autorisent les combinaisons préférentielles de leurs éléments.
Ces relations élémentaires peuvent être «dynamiques», c’est-à-dire qu’elles peuvent évoluer dans le temps. Soit par réorganisation des mêmes éléments (un joueur que l’on change de poste), soit par introduction d’un nouveau. La TSD nomme «paramètres de contrôle» ces petits changements dans les «contraintes» du quotidien (entraînements, méthodes, poste, discours, hygiène de vie, etc.) qui font muter le «système», joueur et équipe, à un plus haut niveau de réalisation. Au lieu de changer, ou d’introduire, on peut aussi soustraire un élément du système. Lorsque Pep Guardiola relégua Ibrahimovic sur le banc, ce fut pour le Suédois la dernière des infamies, mais l’évolution du système Messi ne se heurta plus aux flamboyances d’un soliste qui, le plus souvent, n’étaient qu’à elles-mêmes leur propre fin.
Un joueur unique dans un moment unique
La TSD nous fait voir la part du «dehors», petite ou grande, dans les actions, admirables ou communes. Sans rien enlever de leurs mérites, les meilleurs, pas moins que les médiocres, sont relatifs à leur «environnement». Petit ou grand. Ainsi de Mozart, dont la puissance du système musical a subi tout le poids d’une certaine configuration des structures sociales de son époque. Comme le rapporte le sociologue Norbert Elias, «Beethoven naquit en 1770, près de quinze ans après Mozart. Il parvint, certes non pas sans difficulté, mais avec beaucoup moins de peine, à ce que Mozart rechercha toujours en vain: se libérer presque entièrement du patronage de l’aristocratie […] de manière à pouvoir obéir dans ses compositions à ses propres voix intérieures – ou plus exactement à la logique immanente de ses voix – plutôt qu’au goût conventionnel de sa clientèle.» Ici, c’est bien d’une limitation du système Mozart par son «environnement» qu’il s’agit.
Dans le même ordre d’idée, il est remarquable que la puissance pleine et entière du «système Messi» (que tous les entraîneurs de la Masia, il est vrai, subodoraient sans peine) coïncida avec un moment très spécial de l’histoire du club qui, contrairement à Mozart, joua en sa faveur: en propulsant le «système Guardiola» sur le devant de la scène, le club permit aux théories du professeur Seirul-Lo, par ailleurs déjà bien présentes, d’atterrir comme jamais sur le terrain. On ne le sait sans doute pas, ou trop peu, mais les méthodologies dont nous sommes redevables à l’éminent professeur, «l’entraînement structuré» et les «espaces de phase», sont directement inspirées de la théorie des systèmes dynamiques, et avaient pour enjeu d’asseoir et de sophistiquer comme jamais ce «jeu de position» commandant à tous d’être attentifs à chacun qui irriguèrent si fort les «voix intérieures» du petit astre argentin.







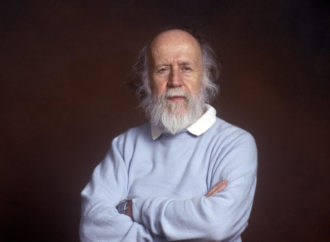
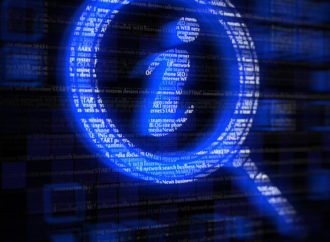





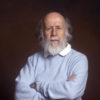













Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *