En Europe ou aux Etats-Unis, on s’est parfois émerveillé, au début de la pandémie, à la vue d’animaux se hasardant dans les centres-villes, en l’absence de trafic automobile et d’humains, confinés. C’est ainsi que des sangliers ont été aperçus à Barcelone, des canards à Paris, ou des pumas à Santiago du Chili. Plus près de
En Europe ou aux Etats-Unis, on s’est parfois émerveillé, au début de la pandémie, à la vue d’animaux se hasardant dans les centres-villes, en l’absence de trafic automobile et d’humains, confinés. C’est ainsi que des sangliers ont été aperçus à Barcelone, des canards à Paris, ou des pumas à Santiago du Chili. Plus près de nous, un chevreuil s’est perdu dans un parking souterrain bâlois, et le grand orchestre des oiseaux a fait son bruyant retour, dans le silence stupéfait d’un monde tournant au ralenti. Dans de grandes mégalopoles aussi, la pollution a d’un coup diminué avec la suspension du trafic automobile, et l’air est devenu plus limpide. C’est la preuve que la nature est rapide à reprendre ses droits, se félicitaient les plus optimistes, à la moindre pause elle revient en force, la Terre n’a pas dit son dernier mot! (Oubliant que c’est l’espèce humaine qui est en péril, plus que la planète.)
Lire aussi:
Quand l’être humain n’est pas là, les oiseaux chantent
Mais que vaut une biche descendue plus bas dans une vallée du Jura face à des dizaines de milliers d’habitants d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique latine ou d’Asie chassés des villes par la pandémie et le chômage, et retournés dans la forêt ou à la campagne pour tenter de survivre? Les experts s’accordent pour dire que le coronavirus a rendu plus intense la pression sur les ressources naturelles, avec la hausse de la déforestation, du braconnage alimentaire ou du trafic d’espèces protégées. Bien sûr, ces images feel-good du début du printemps étaient anecdotiques et ne disaient que notre indécrottable besoin d’optimisme, et une attention plus grande portée à la nature depuis nos fenêtres ou nos balcons (ce qui compte aussi).
Alors que la France continue son confinement, la faune reprend sa place dans la capitale. Les canards ne restent plus sur les quais de Seine mais se baladent désormais dans les rues calmes de Paris en début de soirée, près de la Comédie Française par exemple #AFP #covid_19 pic.twitter.com/mY2oBzYYuB
— Agence France-Presse (@afpfr) March 28, 2020
Mais à long terme, la crise sanitaire aura peut-être des effets bénéfiques si elle sert de déclic en rappelant la dépendance des humains envers la nature, et la nécessité de préserver, voire restaurer des écosystèmes sains et robustes. La crise pourrait ainsi procurer une fenêtre de tir temporelle vers une occupation de la planète moins brutale, en dessinant la voie d’une transition écologique. Un exemple minuscule serait celui des grandes villes, comme Barcelone, Paris ou Genève, qui ont profité de pauses forcées pour devenir plus vertes et résilientes en transformant par exemple leurs autoroutes urbaines en pistes cyclables. Certains noteront aussi que c’est fin 2020 que la masse totale d’objets humains a dépassé la biomasse globale, autre signe d’une année charnière. Peut-on tirer un bilan de ce que le coronavirus a fait à la nature, un an après avoir été repéré officiellement pour la première fois? Le point en quatre débuts de chapitres – la fin de l’histoire reste à écrire.
1. Et tout d’un coup, l’air est devenu plus clair
Dès le début de la crise sanitaire, des images saisissantes se sont étalées dans les journaux et sur les réseaux sociaux: Manille, Beyrouth, Téhéran ou Paris avaient retrouvé une ligne d’horizon. Les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines ont chuté grâce à la diminution du trafic automobile, grâce à la fermeture d’usines et à une baisse générale de l’activité et de la consommation: en quelques jours, l’air était redevenu plus pur et transparent. Des études ont documenté des effets bénéfiques en matière de santé publique en Inde par exemple. Un effet spectaculaire mais bref: la reprise de l’activité est immédiatement liée à un redémarrage de la pollution atmosphérique. La ville de New York, où la pollution aux particules fines avait baissé de 59% en avril et en mai, a ainsi connu un rebond spectaculaire de 33% de ces émissions en juin et juillet, selon le World Air Quality Index. Même tendance dans la ville du Cap ou à Madrid, tandis que Hongkong, Singapour ou Sydney sont restés à des niveaux inférieurs au début de la crise sanitaire.
Barcelone est une ville fantôme, les sangliers du parc de Collserola en profitent pour descendre en centre ville https://t.co/hZHJnS3SiJ
— Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) March 20, 2020
Lire aussi:
Augustin Fragnière: «La relance économique risque de s’accompagner d’un rebond des émissions de CO2»
2. Effet insignifiant sur le réchauffement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont chuté de 7% en 2020, selon une étude internationale Earth System Science Data publiée mi-décembre: c’est la plus forte baisse depuis 1945. Selon le GlobalCarbonProject, la baisse est même de 12% en moyenne en Europe et aux Etats-Unis. Pour fixer l’ordre de grandeur: c’est le même effort qu’il faudrait faire chaque année pendant les dix prochaines années pour arriver aux seuils fixés par l’Accord de Paris sur le climat, afin d’éviter la poursuite du réchauffement climatique. La baisse de 7% ne va donc rien changer à la tendance actuelle qui mène à un réchauffement de plus de 3°C d’ici à la fin du siècle: le Covid-19 a eu un effet «insignifiant» sur le réchauffement climatique, ont estimé les experts de l’ONU lors du 5e anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat. Même l’arrêt de l’aviation, pour spectaculaire qu’il soit (l’IATA évoquait fin novembre une baisse de trafic de 66% sur l’année) n’y change pas grand-chose: l’aviation représentait ces dernières années 3% des émissions annuelles de CO2.
Lire aussi:
Cinq ans après l’Accord de Paris, où en est le combat climatique?
La question de la qualité de la reprise sera donc capitale, l’exemple de la Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, représentant plutôt un contre-exemple: ses émissions de CO2 qui avaient chuté en février et en mars sont revenues au niveau de 2019 dès que le pays s’est remis au travail; elles l’ont peut-être même dépassé en cette fin d’année.
3. Le retour en grâce très problématique du plastique à usage unique
Les chiffres donnent le vertige. L’Union européenne a importé pour 14 milliards d’euros de masques au 1er semestre 2020 selon Eurostat, soit une hausse de 1800% par rapport à 2019. Le monde consomme chaque mois entre 90 et 100 millions de masques, selon l’OMS. Leur polypropylène, un dérivé du pétrole, les classe dans la catégorie des matières thermoplastiques: ils ne sont donc pas biodégradables, et sont très peu recyclés. La pandémie a aussi entraîné la production de centaines de millions de surblouses, de charlottes et de chaussons, le tout faisant peser une hypothèque considérable sur le recyclage des déchets médicaux. Alors que dans l’Union européenne 2021 doit voir s’appliquer une nouvelle directive sur l’économie circulaire et la réduction des plastiques à usage unique, la consommation de ces plastiques a bondi pour des raisons d’hygiène, d’autant que la chute de la demande de produits pétroliers a tiré à la baisse le prix de la production de plastique, renchérissant automatiquement le prix des plastiques recyclés. Selon des études australiennes, la production de déchets a augmenté de 10 à 20% dans les foyers, et a été multipliée de 10 à 20 fois dans les établissements médicaux des pays industrialisés. En Europe, l’association ZeroWaste a lancé un cri d’alarme: «Le recours au jetable, dans l’urgence du début de la crise sanitaire, semble se transformer en une nouvelle normalité.»
Lire aussi: Masques, gants, lingettes… Que faire des déchets liés au Covid-19?
4. Les animaux victimes du covid
Qu’ont de commun le porc-épic, l’oie sauvage, le héron, la foulque, le rat géant à ventre blanc ou le serpent à anneau doré? Ils font partie des 64 espèces sauvages que la Chine s’est engagée cette année à mieux préserver en interdisant leur élevage et en renforçant les sanctions contre les contrevenants. Protection renforcée aussi pour le pangolin, animal le plus braconné du monde en raison de sa chair délicate et de ses écailles faisant partie de la pharmacopée chinoise traditionnelle: comme pour le panda, son commerce est désormais illégal. Les experts redoutent pour autant l’effet pervers de la décision, sa rareté rendant peut-être le petit animal encore plus précieux et pourchassé. C’est peut-être par son intermédiaire que le coronavirus a franchi la barrière des espèces en provenant de la chauve-souris, réservoir possible de la souche du nouveau coronavirus.
Le coronavirus a ainsi contribué bon gré, mal gré, à une meilleure prise en compte de la biodiversité. D’autant que commencée avec les pangolins, 2020 se termine avec le martyre des visons, dont la fourrure est la malédiction. En novembre, l’abattage de 17 millions de visons d’élevage au Danemark, plus gros éleveur du monde, par crainte d’une nouvelle souche épidémique, a provoqué l’effroi. L’élevage intensif est une nouvelle fois sur la sellette. En mettant en valeur l’interdépendance entre géosphère, biosphère et anthroposphère, la pandémie a montré la nécessité que la cohabitation était devenue trop instable entre toutes les espèces animales, humains compris. La nature, dont l’humain est une partie, a besoin de systèmes plus complexes, divers et résistants.







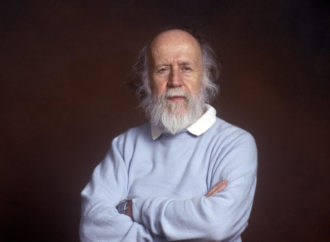
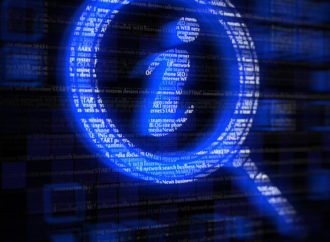





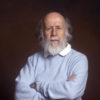













Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *