Autrefois péjorative, l’expression «cervelle d’oiseau» semble définitivement avoir fait son temps. On savait déjà les oiseaux, et en particulier les corvidés – famille qui comprend les corbeaux, corneilles, pies et autres geais –, capables d’utiliser des outils, de résoudre des énigmes géométriques, et même d’anticiper un avenir proche. On les découvre désormais également dotés de
Autrefois péjorative, l’expression «cervelle d’oiseau» semble définitivement avoir fait son temps. On savait déjà les oiseaux, et en particulier les corvidés – famille qui comprend les corbeaux, corneilles, pies et autres geais –, capables d’utiliser des outils, de résoudre des énigmes géométriques, et même d’anticiper un avenir proche. On les découvre désormais également dotés de conscience.
Cette affirmation, qui s’appuie sur une étude parue à la fin du mois de septembre dans la revue Science, est loin d’être anodine. Elle vient en effet relancer les débats souvent vifs autour de la conscience animale, battant en brèche l’idée bien ancrée que la conscience serait une prérogative exclusive de l’être humain, voire des grands singes et quelques rares mammifères dits «supérieurs».
Lire aussi:
Comme les grands singes, les corbeaux peuvent aussi entrevoir le futur
Longtemps négligées par la communauté scientifique, les études dédiées à la cognition animale ont fleuri depuis 2012, date à laquelle un collectif de scientifiques de premier plan – dont le physicien Stephen Hawking – signait la Déclaration de Cambridge sur la conscience. Ceux-ci y affirmaient notamment que «les humains n’étaient pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent de la conscience», appelant, par la même occasion, à intensifier les recherches afin de mieux appréhender cette capacité des animaux.
Mais comment étudier la façon dont les animaux perçoivent leurs propres mondes, leurs expériences subjectives de l’environnement et de leur corps, alors que ceux-ci ne peuvent communiquer verbalement le contenu de leur vécu? Afin de dépasser cette difficulté et d’apporter des éléments de réponse, plusieurs approches ont été développées. L’une d’elles consiste à faire passer aux animaux des tests comportementaux – adaptés et identiques dans leur conception à ceux utilisés chez l’homme –, tout en procédant, en parallèle, à des analyses des réponses cérébrales. L’idée étant de repérer ce que l’on appelle les «corrélats neuronaux» de la conscience, à savoir les changements neuronaux qui se produisent en même temps que la prise de conscience.
Lire aussi:
Les grands singes ont de l’esprit
Pour observer ces fameux corrélats neuronaux de la conscience, deux techniques peuvent être utilisées: l’électroencéphalogramme, qui consiste à placer des électrodes sur le crâne afin de suivre la propagation des signaux électriques par lesquels communiquent les neurones, ou l’imagerie par résonance magnétique qui permet d’observer l’augmentation du débit sanguin dans une ou plusieurs zones du cerveau, un phénomène que l’on considère comme un marqueur de l’activité cérébrale.
Une conscience sensorielle
Mais revenons à nos oiseaux. La recherche en question, conduite par l’équipe du professeur Andreas Nieder, responsable de la chaire de physiologie animale de l’Université de Tübingen, en Allemagne, est non seulement, pour l’heure, la seule du genre à avoir été menée sur des non-primates, mais aussi la première à établir, chez les oiseaux, l’existence d’un processus de conscience primaire, dite conscience sensorielle ou perceptive.
Les corvidés ont non seulement des expériences subjectives de stimuli visuels, mais ils peuvent aussi accéder à ces mêmes expériences pour les rapporter, ce qui est l’attribut de la conscience sensorielle
Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont entraîné deux corneilles noires à réagir à la présence éventuelle d’un stimulus visuel – un carré gris de faible intensité – s’affichant de manière aléatoire et fugace (trois dixièmes de seconde) sur un écran noir. Après un délai de plus de deux secondes, les oiseaux recevaient une consigne – en l’occurrence un carré rouge ou un carré bleu – les informant de la manière dont ils devaient réagir. Lorsque le stimulus avait été présenté, un carré rouge signifiait à la corneille qu’elle devait confirmer l’avoir perçu alors qu’un carré bleu l’interdisait, et inversement dans le cas où aucun stimulus n’avait été projeté.
Voir aussi notre série d’été sur les oiseaux: Secrets d’oiseaux, le règne de la plume
En parallèle, les scientifiques ont enregistré les données concernant l’activité neuronale chez les corneilles, en plaçant des électrodes au niveau de leur pallium, une structure cérébrale dont il a été démontré, dans une autre étude parue en septembre dans Science et conduite sur des pigeons et des chouettes effraies, qu’elle comprenait jusqu’à 2 milliards de neurones (soit autant que certaines espèces de singes) mais aussi qu’elle possédait une neuro-architecture (un réseau de fibres organisées en angle droit) similaire au cortex des mammifères. Le cortex étant la région que l’on associe traditionnellement aux fonctions élaborées, telles que la mémoire, le raisonnement, le langage ou encore… la conscience.
Lire aussi:
Les abeilles ont la bosse des maths
Résultats: «L’activité des neurones suit un processus temporel en deux étapes, précise Andreas Nieder. Au cours de la première, l’activité neuronale reflète principalement l’intensité physique du stimulus visuel. Durant la seconde, nous avons observé une corrélation entre le nombre de neurones activés et l’expérience subjective de la perception visuelle, avec une activité des neurones accrue lorsque la corneille pense subjectivement avoir vu le stimulus mais qui reste silencieuse le cas contraire. L’aspect subjectif est important, car le stimulus visuel est de si faible intensité que l’oiseau peut affirmer avoir vu un carré inexistant ou le contraire. Cela signifie que les corneilles ont non seulement des expériences subjectives de ces stimuli, indépendamment de ce qui leur a été objectivement montré, mais aussi qu’elles peuvent accéder à ces mêmes expériences pour les rapporter, ce qui est l’attribut de la conscience sensorielle.»
Un pilier qui s’effrite
Pour Lionel Naccache, neurologue et chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, ces résultats viennent apporter une pierre de plus à un édifice théorique de la conscience appelé «espace de travail global», qu’il a conçu il y a plus de vingt ans avec Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste, et Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste.
«Cela confirme un des points clés de ce modèle, à savoir la double temporalité liée à la prise de conscience. A chaque fois que nous sommes confrontés à une information, une idée ou un stimulus visuel, les régions perceptives du cerveau vont construire une première représentation inconsciente de ce dernier, l’espace de deux à trois dixièmes de seconde. Puis, si l’on prend conscience de cette information, on constate une amplification soudaine de l’activité neuronale au niveau des cortex associatifs. En cela, le travail très intéressant d’Andreas Nieder vient confirmer, chez les corvidés, des propriétés de la conscience déjà identifiées chez l’homme et les primates non humains.»
Aborder la pensée par l’unique biais des connexions neuronales ne va pas répondre à la question, fondamentale, de savoir pourquoi je pense ce que je pense.
Par ailleurs, avec ces récentes études sur les oiseaux, c’est également un autre présupposé sur la conscience qui tend à s’effriter: «On a longtemps associé la conscience au fonctionnement du cortex cérébral chez les humains et les singes, explique Andreas Nieder. Les oiseaux n’en possèdent pas, mais ils ont développé, au cours de l’évolution, leurs propres structures cérébrales leur permettant de posséder des capacités cognitives complexes et d’être dotés de perceptions conscientes. Cela signifie donc qu’un cortex cérébral n’est pas un préalable nécessaire à la conscience chez tous les animaux.»
Des tensions fortes
Si l’existence de la conscience animale est aujourd’hui largement acceptée dans les milieux scientifiques et philosophiques, il n’en demeure pas moins que des tensions très fortes subsistent entre différents courants de pensée.
«Lorsqu’on tente, en laboratoire, de faire compter les animaux ou de les faire parler à l’aide de dispositifs variés, on leur pose des questions ou on les place dans des situations qui ne sont pas les leurs mais les nôtres, fustige Florence Burgat, philosophe française et directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique. On essaie, de la sorte, de savoir de quoi les animaux sont capables, en tentant de retrouver l’humain dans l’animal, en comparant leurs capacités cognitives à celles d’enfants. Par ailleurs, on assiste à la réduction de la conscience à des corrélats physiologiques. La phénoménologie, une approche qui s’appuie sur l’analyse directe de l’expérience vécue par un sujet, a montré que le champ de la conscience est, en réalité, beaucoup plus large.»
Lire aussi:
Jane Goodall, une vie au chevet des chimpanzés
Florence Burgat estime que ce n’est pas en mettant des animaux devant des ordinateurs que l’on pourra comprendre «leur vie de conscience», mais en décrivant leurs comportements, unique manière de s’en approcher. «Les animaux ne pourraient avoir de comportements cohérents si ceux-ci n’étaient pas d’abord un flux de vécu continu, analyse cette dernière. Quand un animal fait une expérience, de quelque nature que ce soit, il en a conscience et peut s’en souvenir. C’est en ce sens qu’on le dit «sujet de sa vie». En outre, aborder la pensée par l’unique biais des connexions neuronales ne va pas répondre à la question, fondamentale, de savoir pourquoi je pense ce que je pense.»
Lionel Naccache, au cœur de la conversation dans le cerveau
Neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière et auteur de plusieurs ouvrages, Lionel Naccache a dédié ses travaux de recherche à la fascinante question de la conscience
Qu’est-ce que la conscience? Comment définir un des phénomènes les plus insaisissables et subjectifs qui soient? La tâche paraît d’autant plus compliquée que le terme revêt plusieurs significations, que l’on choisisse d’adopter un point de vue philosophique, éthique ou encore religieux.
Mais qu’en est-il du côté des neurosciences? Quelles sont les réponses de cette discipline aux interrogations séculaires sur l’existence de la conscience? Longtemps négligée par la communauté scientifique, l’étude de ce phénomène a notamment permis d’identifier ce que les spécialistes appellent les corrélats neuronaux de la conscience, partant de l’hypothèse qu’à chaque état de conscience (l’éveil, le sommeil profond, le coma, l’état végétatif) correspond un état neural, à savoir une signature cérébrale spécifique observable et objective.
Plus simplement, Lionel Naccache, neurologue et chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, définit la conscience comme «la capacité d’un sujet à se rapporter une représentation ou un état mental», une définition somme toute proche du cogito cartésien «je pense donc je suis». Son dernier ouvrage, Le Cinéma intérieur. Projection privée au cœur de la conscience (Ed. Odile Jacob), propose de mieux comprendre les rouages cérébraux impliqués dans la façon dont nous construisons le monde qui nous entoure. Explications.
Le Temps: On s’est longtemps interrogé sur la localisation cérébrale exacte de la conscience. Or il s’agit davantage d’un dialogue entre plusieurs zones du cerveau…
Lionel Naccache: C’est exact. Nous savons aujourd’hui, notamment grâce aux méthodes de neuro-imagerie cérébrale fonctionnelle, que la prise de conscience d’une information – qu’elle soit visuelle, sonore ou sensorielle – active une conversation entre plusieurs régions du cerveau, pourtant séparées les unes des autres. La communication qui se met en place, cohérente et unifiée, est le fruit de l’activation d’un vaste ensemble de neurones, venant former un seul réseau neuronal global engageant notamment le cortex préfrontal, situé à l’avant du cerveau, et le cortex pariétal à l’arrière, deux zones reconnues pour leurs propriétés associatives. Cette observation est à la base de la théorie que nous avons développée il y a vingt ans avec Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, et que l’on a appelée «espace de travail global».
En quoi cette découverte des réseaux neuronaux de la conscience a-t-elle changé la donne?
Elle a, par exemple, permis de mieux détecter les niveaux de conscience de sujets dans l’incapacité de parler ou de communiquer au décours d’un état initial de coma causé par des lésions cérébrales. Grâce à l’imagerie cérébrale, mais aussi à l’aide de la neuropsychologie, il nous est désormais possible d’observer si ce réseau global fonctionne encore ou si des régions s’activent mais de manière isolée, ce qui n’est pas suffisant pour dire qu’un patient est dans un état subjectif conscient.
Face à la somme d’informations qui nous parvient en permanence, notre conscience agit, selon vous, comme un goulot d’étranglement…
La conscience a cette propriété particulière qu’elle ne peut traiter qu’un seul stimulus ou contenu mental à la fois, or nous sommes en permanence bombardés d’informations. Ces dernières sont traitées, dans un premier temps, de manière totalement inconsciente, au cours d’une étape pouvant durer près de trois dixièmes de seconde et durant laquelle des régions perceptives localisées du cerveau vont construire une représentation du stimulus en question. Ce premier temps de la perception est très riche mais il est aussi très évanescent. Si l’on ne prend pas conscience des informations qui nous parviennent dans ce laps de temps, une sorte de décroissance exponentielle de la représentation mentale va alors s’effectuer.
A contrario, lorsque notre attention se porte sur un élément spécifique, l’activité neuronale s’amplifie soudainement et l’information est alors diffusée à l’espace global grâce à une synchronisation des signaux électriques échangés entre les aires corticales. Cette deuxième étape est caractérisée par un phénomène appelé «amplification attentionnelle», c’est à ce moment-là qu’on prend conscience. L’espace de conversation n’est alors plus occupé que par une idée, qui lorsqu’elle ne sera plus là, sera remplacée par un autre contenu, à la cadence de deux ou trois idées par seconde.
C’est ce qui, au fond, vous fait dire que notre conscience ne serait pas un flux continu, mais plutôt une succession d’états mentaux «discrets».
En effet. On peut comparer cela à une projection cinématographique. Lorsque l’on est assis face à un écran, nous faisons, en réalité, l’expérience d’un film que l’on ne nous a pas montré. Notre perception de ce dernier est continue, mais celui-ci est bel est bien constitué d’une succession de 24 images fixes par seconde. C’est donc notre cerveau qui fait le travail pour inventer, entre deux images, ce qui n’est pas là, assurant la continuité de mouvement et la cohérence temporelle d’une scène.
Ce phénomène de transformation du discret en continu n’est pas propre au cinéma. Nous savons aujourd’hui que notre cinéma intérieur procède à l’échantillonnage d’éléments du monde visuel au rythme d’environ 13 images par seconde, ainsi projetées sur la scène de notre conscience. Ces images fixes sont ensuite montées en un film continu grâce à un mécanisme d’invention, de création de sens qui produit une continuité face à cette succession d’images discrètes.
Selon vous, la propriété essentielle de la conscience serait donc de produire du sens?
Absolument. C’est sans doute là la condition première de l’être humain. Ce mécanisme de création du sens ne s’opère pas seulement au moment où nous réfléchissons à notre vie affective ou nos opinions politiques, mais dès que nous ouvrons les yeux sur le monde. Il nous est toutefois difficile d’en prendre conscience car la première couche de cette construction de sens s’opère en amont de notre conscience.
Notre perception visuelle immédiate est donc une construction subjective et créative. D’une certaine manière nous co-créons le monde qui nous fait face, l’apparence que ce dernier prend pour nous.







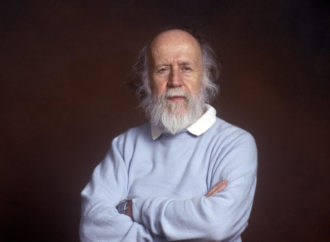
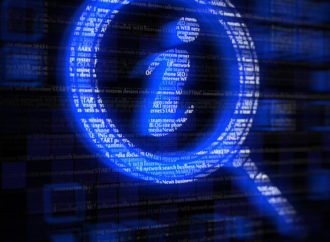





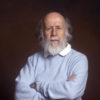













Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *